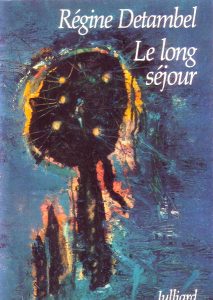
Le Long séjour Julliard
Dit par l’auteur
Du côté de l’auteur
Très tôt j’ai éprouvé le besoin de parler du corps vieilli, vieillissant. Le long Séjour raconte une journée de l’existence de trois personnes âgées dans une maison de retraite. Une journée de la vie quotidienne, douche et petit-déjeuner compris, à L’Age d’or, maison de retraite banale pour personnes âgées.
Trois vieillards auxquels le narrateur s’adresse alternativement, vouvoyant les deux premiers qui forcent encore le respect, tutoyant le dernier, comme si l’extrême vieillesse et ses avatars l’avaient rendu vulgaire, malsain, informe…
Comment s’occupe l’homme de quatre-vingt-huit ans qui se laisse appeler papi ? Comment prend-il goût aux repas quand ses papilles sont usées ? A quoi rêve-t-il encore quand on le toilette ? A quelles coquetteries s’adonne la vieille dame qui ne manqua jamais de rien et qui refuse d’être appelée mamie pour ne pas être dépouillée d’une dernière identité ? A quel abandon s’expose le futur centenaire qui a perdu la tête et qui sert de mascotte débile à L’Age d’or ?
J’avais 27 ans. Je venais de passer quelques mois comme stagiaire kiné dans une maison de retraite municipale et j’étais entièrement habitée par la vieillesse et la façon dont on la traite, dont on la subit. J’avais l’impression d’avoir été enrichie par ce contact. Et de fourmiller de choses à révéler. Mais cela n’a pas donné un livre à la gloire de la sagesse et de la sérénité des cheveux blancs. J’ai écrit plutôt ceci : « Tu n’es ni un homme ni une femme. On t’a vêtu d’une chemise qui t’arrive à mi-cuisse. » Et puis aussi : « Tu entends crisser les pneus du fauteuil qui vient te chercher. Maintenant, tu roules. Le paysage défile. Tu n’en vois que les bas-côtés. La plinthe du couloir, tu la connais. Le pan de mur démesuré qui mène à la baignoire, tu en as l’habitude. Tu ne sais plus garder la tête haute. Tu l’inclines sans cesse. Le poids de ton menton laisse une marque rouge sur ton sternum. Alors tes yeux ne t’autorisent qu’à croiser des orteils multiples, des serpillières, des seaux croupis, des tuyaux de radiateurs, tout ce qui rampe, qui est fil, tout ce qui est secret, tout ce qui est mis à la terre. Ton génie, c’est ton indifférence tellement naturelle, ton expression obscure et trouble, anonyme et profonde. Tu as tellement mûri que tu es mêlé à toutes choses. Il y a un peu de toi dans tout ce qui rampe et qui va à la terre. Tu ignores même ton apparence. »
Et pour finir cette dernière phrase, qui constitue à elle seule le chapitre XII du Long séjour : « Tu as souillé la chemise qui t’arrive à mi-cuisse. Tu appelles. Tu appelles. Tu appelles. Personne ne viendra. Pendant des heures, tu appelleras ta mère. »
Martin Winckler a eu la gentillesse de me confier qu’il conseillait ce livre aux étudiants en médecine. C’est ainsi que j’ai eu vraiment l’impression de pénétrer dans mon écriture. Par les corps aimant, souffrant et vieillissant, et jouissant et mourant.
Extrait
« Vous ne pouvez plus rien faire vous-même. Vous vous laissez faire. L’expression de votre visage est tellement tendue, crispée, que la fille en bleu croit qu’elle vous fait mal. Vous êtes trop lent, voilà pourquoi elle ne vous laisse pas vous laver tout seul. Elle manque à tous ses devoirs. En vous aidant, elle vous perd. Vous ne saurez bientôt plus distinguer les différentes parties de votre corps, votre pied droit de votre pied gauche, votre dos de vos côtes. Bientôt vous ne saurez plus reconstituer le puzzle à savonner.
Vous laissez tomber le gant. La fille l’enfile par-dessus son propre gant de plastique. Vous trouvez qu’elle exagère. Celle-ci n’a pas dû regarder l’émission de télévision qui vantait tout à l’heure les mérites de l’eau pour les ongles à pousser.
Il ne vous reste qu’une mèche de cheveux. Une petite boucle qui vient de votre tempe droite et repose sur votre front. Tout le reste est nu, ou presque. Disons qu’un léger duvet, comme la lèvre d’un adolescent, donne à votre crâne une couleur un peu rousse. C’est très commode pour les filles en bleu. Elles n’ont pas à se munir de la bassine, à diluer le shampooing, prendre la serviette, la brosse à démêler et le peigne à faire des raies. Rien de tout cela. Vous êtes d’ailleurs le pensionnaire le plus propre de l’établissement. Vos cheveux sont lavés tous les jours, du même geste qui passe sur votre cou et vos épaules. Quant à la mèche, elle est mouillée avec le gant, savonnée et puis séchée, tordue dans une serviette comme certaines pièces de linge délicat qu’on ne peut essorer à la machine.
Votre veste de pyjama est posée sur le dossier de la chaise. On vous fait asseoir pour vous laver, asseoir les fesse nues sur la chaise froide. Votre pantalon de pyjama est jeté au pied du lit. Assis, tout nu, votre ventre fait des plis. Votre thorax étouffe votre nombril. Vous avez beaucoup plus de poils sur le thorax que sur la tête. Le gant rapide les nettoie en quelques cercles concentriques. S’il n’y avait que cela.
Chez vous, il y a quelques années, deux gants séchaient sur le bord de la baignoire. Le premier, le plus moelleux, était réservé aux ablutions des parties nobles de votre corps. Le visage, le cou, les aisselles, le torse. À partir de la ceinture, vous usiez d’un autre gant, plus fin, destiné, lui, à passer entre vos cuisses, sous la plante de vos pieds, autour de vos genoux. Ici, cette hiérarchie n’est pas respectée. Le même gant est promis à tous les usages.
Au début, on vous laissait laver vous-même votre sexe. Même, la fille en bleu fermait la porte de la salle de bains et mangeait votre sucre en feuilletant vos magazines. Et puis, par suite de compression de personnel, les filles n’ont plus eu assez de temps. Vous êtes extrêmement malheureux. Vous plaignez leurs amants. Les serviettes sont si rêches. Les plis de l’aine, ce n’est pas possible autrement, ont dû se creuser terriblement. La fille y engouffre presque le tranchant de la main et la surépaisseur des deux gants. Maintenant debout, et tournez-vous. Le gant décolle vos fesses l’une de l’autre. Ensuite, vous vous rasseyez pour tendre vos pieds. Vous n’êtes plus chatouilleux. Vous résistez. Le code d’hygiène est très strict passé un certain âge et vous le remarquez tous les jours. Sauf ce matin, jour de fête, donc d’activités débordantes pour les filles en bleu. Ce matin, la serviette ne s’est pas infiltrée entre vous doigts de pieds. Ce matin, la serviette n’a pas le temps et vous aurez les pieds mouillés toute la matinée dans vos chaussettes trop chaudes. »
Lire le texte intégral de Le long séjour
Lettre à une jeune professionnelle de santé (qui me demandait pourquoi j’avais écrit Le long séjour et comment elle pouvait en nourrir sa pratique quotidienne)
Chère amie,
Merci de votre curiosité.
C’est la préservation de l’identité des vieillards en institution qui m’a soufflé cette idée de trois personnages auxquels on dit « tu » ou « vous », selon leur degré de lucidité et de visibilité sociale (la dame financièrement aisée).
Je suis masseur-kinésithérapeute (dans le civil) et j’ai pu constater dans des services de gériatrie des dérives. Le personnel soignant, confronté à la conduite exaspérante et au langage incompréhensible de vieillards déments, risque de perdre peu à peu sa conviction de se trouver face à un être humain, à une personne digne de respect, et non pas face à un simple objet de soin à manipuler comme un bibelot fragile.
J’ai écrit ce livre pour aider à la compréhension des personnes âgées, et pour le respect de leur identité, malgré la démence, malgré les infirmités.
Je vous confie mes impressions ci-dessous, elles sont précises et circonstanciées et vous prendront un peu de temps à la lecture. Mais c’est un message essentiel et je souhaite qu’il vous parvienne.
Bon dimanche, et mes remerciements vers vous pour l’intérêt que vous portez à mon travail.
*
Mes souhaits à la lecture du Long Séjour. Qu’on y lise ceci :
1) Eviter l’amalgame entre vieillesse et démence
N’en déplaise au général de Gaulle — qui d’ailleurs citait Chateaubriand — la vieillesse n’est pas forcément un naufrage ! Pourtant ce préjugé reste bien ancré. Or le « naufrage sénile » ne concerne pas toutes les personnes âgées. Et il faut rappeler avec force que la vieillesse n’est pas une maladie ! S’il est une crainte qui fragilise les personnes âgées, c’est celle de perdre la tête, de devenir fou. Il faut donc renarcissiser le patient, lui montrer qu’il est compris et surtout le réhumaniser.
2) Garanties de bientraitance
Les qualités humaines du directeur de la maison de retraite influencent grandement l’ambiance de l’établissement et l’efficacité de l’équipe soignante. Sa vigilance éthique sur les comportements des équipes est constante. C’est dire clairement l’ambition des maisons de retraite d’aujourd’hui : accompagner humainement et dignement une personne âgée dans les dernières années de son existence. Car, au-delà des soins prodigués, il faut permettre au résident d’atteindre un équilibre entre la rigueur de la médicalisation et la douceur de la vie quotidienne, entre la vie communautaire et l’intimité.
3) Contre une image négative de la gériatrie
La gériatrie a toujours été mal perçue. Puisque les patients qu’elle traite ne guérissent pas et ne sortent pas de l’hôpital, on la voit comme une mission soignante inefficace et absurde. De plus, le souvenir n’est pas encore effacé des maisons de retraite « mouroirs » ou « pourrissoirs », que dénonça Simone dans Beauvoir dans les années 1970. Enfin, les patients traités — les vieux — sont d’emblée écartés d’une société jeune et saine, résolument « géronto-phobique ». Heureusement, ces perceptions négatives n’entravent généralement pas l’investissement professionnel des équipes de soins qui s’affairent autour des personnes âgées. Les auxiliaires de vie ne sont pas des femmes de ménage. Elles observent, signalent une anomalie, analysent un comportement, et font part à l’équipe de leurs réflexions.
Chaque membre de l’équipe est formé en vue du maintien d’une relation respectueuse avec les résidents. Tous les gestes doivent préserver la dignité des résidents. Ce qui suppose, de la part des professionnels, l’attention à l’autre, la douceur et la faculté de savoir prendre sur soi. Par exemple, apprendre à cacher son dégoût face à un patient souillée, est une manière d’aider cette personne à garder le respect d’elle-même malgré sa perte d’autonomie. Garder un visage et une attitude calmes, en toutes circonstances, requiert un puissant contrôle de soi. Souvent, l’engagement du soignant en gériatrie rejoint celui du soignant en psychiatrie : la façon de dispenser le soin est aussi importante que le soin lui-même.
4) Qu’est-ce qu’une maison de retraite ?
L’assistance permanente à domicile a un coût élevé. Elle suppose une organisation et une solidarité familiale importantes. Vieillir à domicile dépend donc de facteurs familiaux, sociaux et financiers. Tous les vieillards ne sont donc pas égaux. Et la société aujourd’hui se demande si mourir à domicile est un luxe ou si cela doit être considéré comme l’un des droits de l’homme. Or, quand une personne ne peut plus subvenir à ses besoins, elle est immédiatement placée.
La maison de retraite est une institution conçue par la société pour offrir une place à des personnes que leur âge a rendues dépendantes, physiquement et/ou psychiquement. Ainsi, le placement du sujet âgé n’est pas le seul fait de la famille, mais une décision du corps social qui destitue la personne âgée de sa place à son domicile. La décision du placement prévaut souvent sur le désir de la personne âgée dépendante qui souhaiterait, elle, rester à son domicile.
L’événement de s’installer en maison de retraite, et d’y vivre jusqu’à la fin de ses jours, est la plupart du temps affaire de nécessité. L’entrée en maison de retraite est une obligation. Pour la personne âgée, elle est donc un non-choix. Prescrite par le médecin ou commandée par la famille, l’installation est souvent brutale et soudaine. Le plus souvent, à la suite d’une chute ou d’une maladie, une personne âgée est diminuée physiquement, perd une part de son autonomie et ne peut donc plus rentrer chez elle. Le futur résident et sa famille sont pris de court. Il y a nécessité. L’entrée en maison de retraite est donc douloureuse pour tous.
Ainsi l’accueil d’une personne âgée en maison de retraite est bien différent d’une simple admission où l’on enregistre les données administratives du nouvel arrivant. Car le nouvel arrivant est en train de subir l’épreuve de la destitution du chez-soi.
Le moment de l’accueil en institution est l’événement pendant lequel la personne du parent est destituée par l’enfant de sa position de sujet et de sa fonction d’autorité pour prendre la position de personne mineure, d’objet de placement. Pour rétablir la personne âgée dans sa place de sujet à part entière et non de victime, le directeur de l’établissement accueillera la personne âgée en se tournant résolument vers elle, en la considérant comme principal interlocuteur de l’entretien, en laissant apparaître la famille comme un tiers. Dans ce geste, l’institution assigne au nouveau résident la position de sujet responsable de sa vie.
Un processus psychique s’ensuit, qui conduira à l’acceptation de la vie en institution : la résistance à cette vie communautaire. Cette résistance, opposée par la personne âgée à l’institution, signale à l’équipe soignante que la réalité du placement est prise en compte. La personne âgée traverse une épreuve de réalité au terme de laquelle elle acceptera le fait qu’elle ne peut plus subvenir à ses propres besoins. Sa résistance témoigne du travail psychique qu’accomplit la personne âgée pour admettre la réalité de sa dépendance. À travers cette résistance, elle reconquiert la position de sujet, et non celle de victime. Et les personnes qui s’adaptent le mieux sont souvent celles qui ont opposé d’abord le plus de résistance. Non seulement le personnel doit permettre au nouveau résident de formuler ses peurs, d’exprimer ses sentiments négatifs face à la réalité de l’institution, mais il doit également se montrer rassurant, lui expliquer dans le détail le fonctionnement de l’établissement, lui faire visiter les lieux, lui montrer combien l’endroit sera sécurisant pour lui.
Lors des premiers jours en maison de retraite, l’angoisse est normale. On imagine sans peine le désarroi d’une personne âgée entrant dans une chambre anonyme où l’on installe ses objets personnels. Il va désormais falloir faire face à la vie en collectivité. Il semble qu’au début de leur installation, tous les nouveaux résidents ont peur de cette vie future. Pourtant les capacités du sujet âgé à faire face à cette situation et à la dépasser sont réelles. Au fil des jours naissent les repères spatio-temporels et, avec eux, la confiance en soi. Le résident a mesuré son univers et s’y est adapté.
Pour la famille, l’entrée d’un parent en institution est un moment de violence. Désormais le renversement générationnel est consommé. Désormais l’enfant prend en charge le parent. Et cet acte de placement, que souvent personne n’a voulu mais que la nécessité a imposé, est générateur de culpabilité pour l’enfant. De plus, la famille est souvent épuisée, physiquement et psychiquement, et le placement en maison de retraite est un renoncement, une abdication. C’est parfois la fonction de l’institution de rassurer l’enfant et de l’aider à construire une relation nouvelle avec son parent en maison de retraite. Celle-ci est un projet de vie et non pas un endroit où l’on parle seulement d’argent, de linge et de traitement. Mais si la famille délègue à l’institution la prise en charge quotidienne de son parent, elle conserve cependant la responsabilité morale. Ainsi elle se doit de veiller sur la bonne prise en charge que la personne âgée reçoit dans l’institution. Une famille garde toujours le pouvoir de décider que cette prise en charge ne convient pas à son parent. Elle conserve toujours la possibilité de changer d’institution.
5) L’intimité en maison de retraite
En maison de retraite, des auxiliaires de vie s’activent autour de la personne âgée pour l’assister dans son intimité : se laver, aller aux toilettes, se nourrir, se coucher, s’habiller… La personne âgée a été précipitée, du jour en lendemain, dans l’espace anonyme et collectif de l’institution. Cette épreuve qui survient pendant le grand âge met en évidence l’extraordinaire capacité d’adaptation de l’être humain. Car pour s’accommoder de cette nouvelle vie, la personne âgée doit témoigner de sa capacité d’élaborer une vie intime à l’intérieur de la vie collective. Dans un espace où les anciens gestes de l’intimité (ménage, toilette, repas, silence…) sont sans cesse perturbés par le groupe, comment la personne âgée parviendra-t-elle à préserver un espace de solitude, de cette solitude si constitutive de soi, qui l’abritera et la protègera, malgré les horaires et les obligations, de l’intrusion du collectif ? La coexistence des deux domaines — collectif et privé — ne va pas de soi. Car l’espace collectif refuse les odeurs corporelles, le laisser-aller, la sexualité, la désinhibition… L’institution se doit de veiller à l’hygiène parfaite de ses pensionnaires. Ce faisant, elle va à l’encontre de l’intimité de la personne âgée. En effet la vie en collectivité exige de réduire l’odeur personnelle de chacun pour dissoudre les personnes dans l’homogénéisation du collectif. Or l’odeur est une marque de l’identité sur l’environnement, elle est une enveloppe d’intimité. De même que les vêtements préférés par la personne âgée sont souvent tachés ou troués, ce qui est inacceptable dans la vie en collectivité.
Être lavé par un tiers, c’est devoir se faire violence à soi-même. La nudité, la toilette sont une véritable épreuve, encore renforcée par la mixité du personnel. La règle est de ne pas banaliser la nudité et de veiller à ce que l’intimité personne âgée/soignant, au cours de la toilette, soit préservée du regard d’autrui.
L’incontinence est également une épreuve dommageable pour l’estime de soi. Elle signe la perte irrémédiable que la personne pouvait avoir sur la maîtrise de son corps. C’est un deuil psychologique énorme et, malgré le port de protections, les personnes âgées incontinentes ont du mal à renoncer à cette maîtrise acquise durant la petite enfance et réclament incessamment qu’on les emmène aux toilettes. Pour elles, la corvée régulière du change est une épreuve.
La notion de propreté diffère de celle d’hygiène car la propreté est une transmission maternelle, d’abord par le soin maternel prodigué au nourrisson, ensuite par l’éducation. Pour chacun, le rapport à la propreté est donc différent (empreint ou non de coquetterie, maquillage ou non…). Or, en maison de retraite, aux gestes transmis par la mère se substituent les gestes du soignant, techniques et hygiéniques. L’opposition de la personne âgée à l’acte de la toilette effectué par un tiers peut être une réaction à cette effraction du soignant dans le lien primordial mère-nourrisson. Ainsi l’hygiène de la collectivité (règles sanitaires nécessaires à la vie en collectivité) s’oppose t-elle à la propreté intime, qui touche à la mémoire, à la famille, à la culture. L’hygiène s’immisce dans la sphère privée. C’est pourquoi de petits gestes d’attention (l’épilation ou le maquillage, la manucurie, un baiser sur la joue après le rasage ou la caresse du massage pendant l’hydratation de la peau…) viennent adoucir les règles d’hygiène et rendre à la personne l’estime de soi et de son propre corps.
Et c’est également pour que la nécessité de l’hygiène ne détruise pas l’intimité de la personne âgée que l’entretien sanitaire et aseptisant des locaux est doublé, dans la chambre du résident, de la dimension du « ménage ». Le ménage est un soin prodigué à l’univers de la personne âgée et qui lui permet de reconstituer, au sein de l’institution, une sphère intime. N’oublions pas que le résident n’a plus de maison. Or, disait Bachelard : « Si l’on nous demandait le bienfait le plus précieux de la maison, nous dirions : la maison abrite la rêverie, la maison protège le rêveur, la maison nous permet de rêver en paix. (…) La maison est le premier monde de l’être humain. (…) Avant d’être ‘jeté au monde’ l’homme est déposé dans le berceau de la maison. » (Bachelard, Poétique de l’espace, PUF). Pour reconstituer en institution le « chez-soi » de la personne, sa dimension d’abri, de refuge, le ménage a une fonction capitale. Il reconstruit peu à peu, par des gestes quotidiens, un véritable intérieur, c’est-à-dire une sphère d’intime dans ce monde collectif. Prendre soin des objets personnels, c’est reconstituer, au sein de l’institution, ce que Bachelard nomme « la maternité de la maison » : « Tout espace vraiment habité porte l’essence de la notion de maison. Nous verrons comment l’imagination travaille dans ce sens quand l’être a trouvé le moindre abri : nous verrons l’imagination construire des murs avec des ombres impalpables, se réconforter avec des illusions de protection — ou inversement tremblant derrière des murs épais, douter des plus solides remparts. Bref, dans la plus interminable des dialectiques, l’être abrité sensibilise les limites de son abri. Il vit la maison dans sa réalité et dans sa virtualité, par la pensée et les songes. Dès lors, tous les abris, tous les refuges, toutes les chambres ont des valeurs d’onirisme consonantes. » (Bachelard, Poétique de l’espace, PUF)
Bachelard : « Il nous faut dire les rêveries qui accompagnent les actions ménagères. Ce qui garde activement la maison, ce qui lie dans la maison le passé le plus proche et l’avenir le plus proche, ce qui la maintient dans une sécurité d’être, c’est l’action ménagère. Mais comment donner au ménage une action créatrice ? Dès qu’on apporte une lueur de conscience au geste machinal, dès qu’on fait de la phénoménologie en frottant un vieux meuble, on sent naître, au-dessous de la douce habitude domestique, des impressions nouvelles. La conscience rajeunit tout. Elle donne aux actes les plus familiers une valeur de commencement. Elle domine la mémoire. Quel émerveillement que de redevenir l’auteur de l’acte machinal. » (Bachelard, Poétique de l’espace, PUF).
6) Comment toucher le corps du sujet (attention, ce n’est pas un corps, c’est un sujet !)
Pour réduire les risques infectieux inhérents à la vie en collectivité et pour se protéger contre la contagion, le soignant en institution porte des gants. Mais cette protection ne sert pas seulement à lutter contre les microbes. Les gants créent une fine paroi hermétique entre le corps du vieillard et le soignant qu’il protège du dégoût. L’hygiène est donc une nécessité, mais aussi un écran. Par l’usage des gants, le soignant se préserve symboliquement contre la dégradation de son propre corps. Y réfléchir ++.
7) La sexualité du sujet âgé en institution
Si la sexualité de la personne âgée paraît aberrante à certains soignants, c’est qu’ils ont infantilisé le sujet âgé, se sont placé vis-à-vis de lui en position maternante, comme le change, la nourriture à la cuillère et autres gestes quotidiens les y invitent dangereusement. Comment des nourrissons pourraient-ils avoir une vie sexuelle ? pensent-ils. Ils considèrent alors la sexualité du vieillard comme une perversion, le traitent de « coquin ». De plus, la vie institutionnelle prive le sujet âgé de son intimité sexuelle, puisque le personnel soignant fait intrusion jour et nuit dans la chambre du résident. Or la masturbation et l’acte sexuel sont essentiels aussi à la vie du sujet âgé. Et l’orgasme peut arriver jusqu’au bout de la vie.
8) Assister la mort en institution
« Personne ne peut mourir à ma place ou à la place de l’autre » dit Jacques Derrida. La mort donc singularise à l’extrême. L’imminence de l’événement de la mort inaugure une authentique relation à l’autre dans son altérité même, toute possibilité de sympathie (capacité d’éprouver les mêmes sentiments et de se mettre à la place de l’autre) étant devenue désormais impossible.
Derrida, Chaque fois unique, la fin du monde, Galilée, 2003 : « La mort de l’autre, non seulement mais surtout si on l’aime, n’annonce pas une absence, une disparition, la fin de telle ou telle vie, à savoir la possibilité pour un monde (toujours unique) d’apparaître à tel vivant. La mort déclare chaque fois la fin du monde en totalité, la fin de tout monde possible, et chaque fois la fin du monde comme totalité unique, donc irremplaçable et donc infinie. Comme si la répétition de la fin d’un tout infini était encore possible : la fin du monde lui-même, du seul monde qui soit chaque fois. Singulièrement. Irréversiblement. Pour l’autre et d’une étrange façon pour le survivant provisoire qui endure l’impossible expérience. Voilà ce que voudrait dire ‘le monde’. Cette signification ne lui est conférée que par ce qu’on appelle ‘la mort’. »
La responsabilité de la mort de l’autre affecte le survivant jusqu’à la culpabilité : « La mort de quelqu’un n’est pas, malgré tout ce qui en semblait à première vue, une facticité empirique ; elle ne s’épuise pas dans son apparaître. Quelqu’un qui s’exprime dans la nudité — le visage — est un au point d’en appeler à moi, de se placer sous ma responsabilité : d’ores et déjà j’ai à répondre de lui. La mort d’autrui qui meurt m’affecte dans mon identité même de moi responsable […] faire d’indicible responsabilité. C’est cela, mon affection pour la mort d’autrui, ma relation avec sa mort. Elle est, dans ma relation, ma déférence à quelqu’un qui ne répond plus, déjà une culpabilité — une culpabilité de survivant. » (Lévinas, La mort et le temps, PUF, 1989)
Le mourant est confié au soignant, investi, au-delà de sa responsabilité professionnelle, dans sa responsabilité d’homme. Cette injonction morale est aussi forte qu’une prise d’otage, dit Levinas. Parfois le soignant éprouve la blessure morale de la culpabilité : sentiment de ne pas en avoir fait suffisamment.
Heidegger (Etre et temps): « Nous n’éprouvons pas au sens fort du terme le trépas des autres : nous ne faisons tout au plus qu’y assister. (…) Nul ne peut décharger l’autre de son trépas. Quelqu’un peut bien aller à la mort pour un autre. Toutefois cela revient toujours à dire : se sacrifier pour l’autre. Mais mourir ainsi pour l’autre ne peut jamais entraîner que l’autre ne serait de la moindre façon déchargé de sa mort. »
L’institution s’engage à assister la personne jusque dans le mourir. Quand une personne âgée entre en maison de retraite, elle vient pour y mourir. Pour l’institution, se voir confier la mort d’un être est une véritable mission. L’admission en maison de retraite signifie qu’on confie à cette maison la qualité de sa propre mort. Les soignants en maison de retraite détiennent donc la sagesse du mourir, ils travaillent et aident au mourir, comme les doubles inversés des soignants en obstétrique. Porter la personne jusqu’à la mort, tout en lui faisant la vie douce, dans la sécurité et la sérénité, est un énorme travail.
Qu’est-ce que mourir dans la dignité ? Mourir dans la dignité dépend du mode d’assistance porté au mourir. La dignité est un attribut humain inaliénable, pourtant elle peut être bafouée. C’est donc à l’institution et aux soignants qui assistent la personne âgée dans la mort, en lui accordant toute sa place de sujet dans sa manifestation ultime de sujet, que revient la responsabilité de la dignité dans le mourir.
Cependant, il n’est pas question d’associer la maison de retraite au mouroir sous peine d’angoisser et de culpabiliser à la fois les résidents et les familles. Il serait plus juste de dire que la maison de retraite doit être un lieu où l’on assiste le sujet âgé tout au long de son existence et jusque dans son mourir. Mais la maison de retraite n’est pas une propédeutique au mourir, elle se veut d’abord un lieu de vie, un lieu sécurisant où l’on sait encourager la personne à profiter de tous les instants de son existence.

