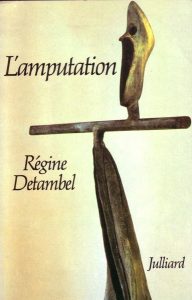
L’Amputation Julliard
Dans une imprimerie désaffectée vivent de jeunes plasticiens, sculpteurs et peintres, et une lectrice. Une nuit, la main droite de Delarc est littéralement dévorée par le bloc de diorite qu’il rêvait de faire vibrer. Dérisoire Prométhée enchaîné à son chef-d’œuvre, Delarc est désormais prisonnier de sa création…
Extrait
« Tu te réveilles lentement. Tu permets à ta conscience un bref repérage des lieux, un aperçu du répertoire de tes sens. Tu décroises les jambes, remues la tête pour te resituer au coeur d’un équilibre. Ton sommeil a repoussé la table de quelques centimètres, t’a fait quitter une espadrille. Tu bâilles pour recouvrer la plastique de ton visage qu’un éventuel rêve à pu marquer. Enfin, tes yeux s’ouvrent.
La pierre forme, avec le plan de ta main gauche posée sur l’une de ses arêtes, un angle d’environ soixante degrés. Ta main droite, elle, a disparu dans une profondeur discutable de diorite.
Ton bras semble finir à hauteur de montre. Une ouverture ovale a dévoré ta main. Une violente nausée te prend, te redresse, te secoue le bras. Cette douleur déclenche le cri. Ta main prise, dont tu ne sais plus quelle position elle peut occuper — si tes doigts sont tendus, repliés ou encore simplement à demi fermés dans la position de l’écriture —, est parcourue de morsures, de fourmillements indicibles, d’élancements, d’une gamme de prurits qu’une instinctive friction devrait soulager. Et l’effroi te pousse, sourd à la raison, à griffer la pierre, la cogner contre le sol, l’ôter de ta vue dans des convulsions épileptiques. Il faut que tu fasses l’appel de ton corps, que tu vérifies l’intégrité des membres qui te restent. Tu voudrais pouvoir les palper mais cette masse, à bout de bras, lestant tout ton côté, séquestre ton attention. Elle menace ton front, ta tête, s’oppose aux tentatives angoissées que tu multiplies pour dérouter son accablante pression. Tu te roules, tu te traînes, tu rampes pour te libérer la main dans des contorsions qui t’étirent le poignet, te détachent le coude, te déracinent l’épaule, te désinsèrent tous les muscles. T’écartèlent, te dissèquent. Même au sacrifice de ton bras tout entier, tu es prêt à tirer, à t’arc-bouter. Entre ta peau et la diorite filtre un minuscule intervalle où tu glisses un burin qui te taillade, porte à tes veines des coups de plus en plus profonds. La douleur t’extorque un sursaut et la pierre, emportant ton bras dans un élan incontrôlable, crève la toile près de toi. Tu te vois perdant, te sens un perdeur. Tu pleures. L’extravagance d’une telle situation ne te permet pas de t’innocenter. Ainsi le saccage laisse place à un calme insolite où se trace le canevas de ta fuite. Tu t’enveloppes l’avant-bras de quelques feuilles de papier, caches le tout sous ta veste. Le coude plié, le tissu déformé, la manche vide, tu sors. Tu ne sais plus si c’est un corps étranger, une énorme tique, ou bien au contraire un kyste, une tumeur qui viendrait de toi. Tu te vois inaugurer de nouveaux gestes, de nouveaux rites, ta vie minérale.
Tes errances aspirent aux quartiers secrets de Marseille, aux avenues peu fréquentées, aux ruelles où l’on pensera que tu serres contre toi un bras blessé ou cassé ou paralytique, que tu es un handicapé, un petit voyou victime d’un règlement de compte, un sportif qu’une action déloyale a terrassé. Éviter la curiosité que de trop rares promeneurs, de toute façon, ne t’accordent pas, t’oblige à raser les murs, longer les gouttières, stationner sous les portes cochères. Tu marches longtemps, tête baissée. Enfin, la vitrine d’un grand magasin t’arrête. Des mannequins, encore nus, te rabâchent, duplicata désormais caducs, leur anatomie de plastique. Bien sûr, tu maudis leur perfection et ce qui reste en toi de sculpteur explore les ridicules de leurs poses. L’un d’entre eux te montre du doigt. Un autre, partiellement dissimulé derrière un voile de coton, n’a ni tête ni mains. En t’écartant d’un pas pour provoquer ton propre reflet dans la vitre, tu désobéis à la règle que tu t’es imposée : ne pas voir pour ne pas défaillir encore. Ta silhouette t’apparaît, finalement, comme celle d’un individu porteur d’un objet clandestin. Des passants s’attardent sur la bosse qui gonfle ta veste, se demandent ce que tu caches, si tu as raté un rendez-vous ou perdu ton chemin. Leur indiscrétion te remet en marche, jouet dont ils auraient remonté le ressort, te pousse à quitter la vitrine. Tes pas, moins timides, te conduisent maintenant à la gare Saint-Charles.
La pression faiblit sur ta main désormais anesthésiée, un nouvel assaut de peur t’empoigne en songeant que la chaleur distillée par la foule fera enfler tes doigts, t’infligera un supplice toujours plus cruel. Dans l’espoir qu’elles seront désertes, que leurs glaces n’en seront pas brisées, tu entres dans les toilettes pour hommes. Tu déchiffres les murs, les urinoirs, les miroirs souillés de graffiti au feutre, à la bombe de peinture, au bâton de rouge à lèvres — jours et heures de rencontres, numéros de téléphone, coeurs aux initiales entrelacées, sigles de partis politiques, surchargés, ridiculisés, prénoms, diminutifs, maximes tronquées, slogans, verges schématiques aux testicules disproportionnés —, où les mots merde, où les mots con, en fond de décor, liant inséparable des parois publiques, jouent leur rôle de frises. Barricadé dans des chiots quasi impraticables tant il traîne d’ordures, tu déballes la diorite, t’agenouilles, assènes un premier coup contre le sol. Les cloisons résonnent, les néons vibrent, des éclats de faïence giclent. Personne n’accourt et tu récidives. Les tuyauteries tremblent à se briser, un flux d’ondes douloureuses se transmet à ton poignet, te court le long du bras, te rampe dans le cou, t’encercle la tête. La perte de ta main implique plus qu’une paume, quelques nerfs et tendons mais ton corps tout entier qui réclame son bien, lutte contre l’aliénation de l’un de ses membres avec une jalousie d’ancêtre. L’ardeur à briser ton carcan sur le carrelage diminue et ne produit, en fait, que du bruit.
La pierre au ventre, tu ressors. Personne ne t’épie, rien ne te guette. Tu parviens avec un balai à bloquer temporairement la grande porte d’accès.
Tu es prêt à affronter l’image.
Face à la glace, soumis à la peur de celui qui, blessé, sait que le sang coule et veut, posément, pour préserver sa raison, attendre de constater l’étendue des dégâts, leur coefficient de gravité, tu serres les paupières. En somme, tu te concentres à la façon d’un comédien qui entre en scène, sans rien imaginer d’avance. Ta mémoire ne te soutient pas, ne t’est d’aucun secours, ne t’offre rien, ni souvenir d’enfance, ni page de livre, ni séquence de film, rien de comparable. Quand, par hasard, une image fugace se met à concorder avec ton inexplicable aventure, c’est une gueule féroce de squale, de saurien, de fauve qui te happe.
Tu laisses ton bras s’assouplir, perdre l’insolente flexion que tu lui imposais, crampes nées dans la doublure de ta veste, qui essorent tes muscles. Quand tu ouvres les yeux, c’est ton visage qui s’inscrit au miroir ; sa forme, sa mimique, moins défaite que tu ne le craignais, son teint, moins pâle aussi, la position de tes lèvres définissent une figure que, contre toute attente, tu reconnais.
Tu pourrais, sous l’emprise d’une chaleur insupportable, sourire pour craqueler ton masque de figurant, te laisser aller au fou rire pour faire passer, dans une extase nerveuse, ta nausée, ou pincer les lèvres, serrer les dents, contracter les masséters, froncer les sourcils, plisser le front, gonfler les joues, te mordre la langue, avancer la mâchoire, te distendre la bouche, te dilater les narines. Ton visage, calme, attend de voir. Ton regard descend le long de ton autre : son cou, ses épaules, le renflement musculeux, presque féminin de sa poitrine, le creux de son estomac, le matelas de son ventre. Vrai plan américain, le miroir s’arrête là, au niveau de la ceinture, et tu dois reculer d’un pas, te coller contre une porte pour qu’apparaisse, presque tout entier, ton corps. Tu n’es pas capable encore d’englober ta silhouette dans une vue d’ensemble. Tu regardes fixement la diorite.
En suspension, légèrement appuyée contre le bord de ton genou, elle est sens dessus dessous, du moins c’est la première impression que tu as. Tu portes le bras en l’air pour la redresser. Il ne t’en faudrait pas beaucoup pour qu’elle te paraisse là depuis toujours, ton envers inséparable, caricature de ta nuque, des os de ton crâne. Son poids a maintenant domestiqué tes muscles. Tu l’observes. Elle s’enroule, se love. Les cristaux blancs du feldspath, verts de l’amphibole, forment torsade, spire, chaîne hélicoïdale autour de toi. La grossière taille effectuée n’est plus visible ; les heurts, les marques ont disparu au profit du délicat, des éclats de joaillerie, d’une indéniable finition. Tu rapproches la pierre du miroir et, simultanément c’est la sculpture que tu rapproches du miroir. Déjà un nom s’impose : Pooh-Bah. Tu l’appelleras Pooh-Bah. Déjà tu t’assures que les coups de boutoir contre le sol ne l’ont pas endommagée, tu cherches à détecter une fissure, un tassement, une fêlure, un écrasement, un aveuglement des cristaux. Tu vérifies que ta sueur, ton sang qui a perlé au contact irritant de sa base, au tranchant du burin, ne l’ont pas maculée. Elle est bien de toi et le soin jaloux que tu prends à l’envelopper du regard le confirme… »
Lire le texte intégral de L’Amputation
N.B. Dans l’édition originale de 1990, aux éditions Julliard, le texte de L’amputation est suivi d’un petit texte inclassable intitulé Table des manières/Exemples, préfiguration de L’Ecrivaillon ou l’enfance de l’écriture.

