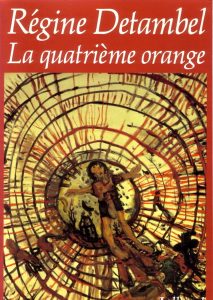
La Quatrième orange Julliard
« Tout le roman s’articule autour d’un drame annoncé dès le début du récit : la mort accidentelle de Saligia, une élève de quatrième.
Avec une férocité méticuleuse, Régine Detambel a épinglé tout vifs les secrets de l’adolescence, nous livrant au passage les clés du dortoir, de la cantine et même des cellules, où les religieuses cachent leur mystérieuse féminité… » – Gabrielle Rolin (L’Express)
Présentation de l’éditeur
Une classe de quatrième, la quatrième « orange », du dortoir à la cour de récréation. L’école de la nuit et du jour. Acteur et témoin, le choeur monolithique, monocorde, des jeunes pensionnaires qui oeuvrent avec soin à la destruction du bouc émissaire qu’elles se sont choisi.
Saligia, une élève bien différente des autres, sorte de poupée malade et favorite des religieuses pour des raisons qui lui échappent, engagée avec la responsable de l’établissement dans une relation amoureuse qu’elle ne peut concevoir, est le souffre-douleur nécessaire à l’harmonie de la classe.
La Quatrième orange, c’est l’adolescence enfermée dans un pensionnat, et d’autant plus sciemment, redoutablement cruelle. Trente et une élèves, un dortoir, une soeur vêtue de noir, un professeur de gymnastique et une corde lisse travaillent à l’accomplissement du drame.
Après Le long séjour, où Régine Detambel relatait sans complaisance une journée dans une maison de retraite, La Quatrième orange vient en écho, une vie plus tôt.
Extrait
« Avant
et
pendant
les
années
mil
neuf
cent
soixante‐dix,
nous
étions
pensionnaires
dans
une
ville
du
nord
de
la
France.
Nous
quittions,
le
dimanche
soir,
la
maison
de
nos
parents. Nous
les
retrouvions,
le
samedi
suivant,
avec
la
hâte
d’aller
de
nouveau
nous
abriter
dans
notre
chambre
(parfois
belle),
en
tous
cas
notre
vraie,
notre
chambre
originelle.
Alors
les
stalles
alignés
du
dortoir
étaient
reléguées
de
l’autre
côté
de
nos
mémoires.
Le samedi, à onze heures trente, la Quatrième orange, classe des pensionnaires, était tout entière assise sur le trottoir. Onze heures passées, samedi, nos cartables contenaient de grands cahiers sales, à carreaux. Nos valises étaient pleines de linge, sale également, que nous n’avions pas su replier. Nous aurions pris soin d’un pantalon neuf, défroissé les manches de la blouse si elle avait senti bon. Mais ce linge de sept jours, une fois souillé, désormais malodorant, comme si l’entassement ajoutait encore au poison de la sueur et des excrétions honnêtes, ne s’était pas laissé ranger sans impatience. C’est notre pli, notre forme, notre allure, qui lui donnaient, au linge, des épis, et qui le rendaient, ce linge, de plus en plus rebelle. C’est pourquoi les valises semblaient toujours plus remplies au retour. Pourquoi nous avions l’air d’être assises sur une garde-robe en bouchon, le samedi, après onze heures, quand toute la Quatrième orange attendait sur le bord du trottoir. »

